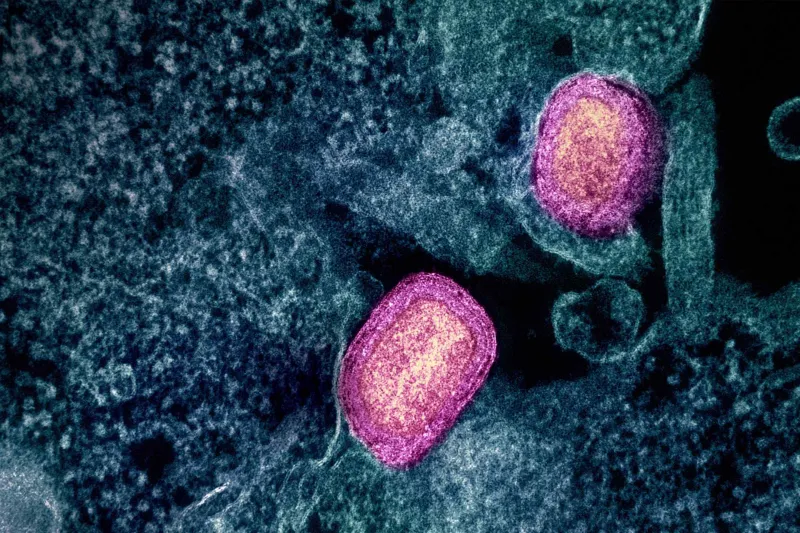« Laisser sa chance à la nature »
En 1994, l’ouverture de la Grande Galerie de l’Évolution offrait un espace inédit dédié à l’évolution, la biodiversité et aux relations de l’Homme avec son environnement. 30 ans après, quelle est désormais notre vision de notre planète ? Et quelles sont nos connaissances de sa biodiversité ? Des chercheurs du Muséum font le point.
Grégoire Loïs, ornithologue et directeur-adjoint du programme de sciences participatives Vigie-Nature, revient sur le déclin des espèces communes.

Grégoire Loïs, ornithologue et directeur-adjoint du programme de sciences participatives « Vigie-Nature »
© MNHN - J.-C. DomenechEn quoi consistent les sciences participatives ?
Il s’agit de mobiliser des personnes, naturaliste-amateur, jardinier, promeneur… pour recueillir des données d’observation. Ce type de contribution a toujours existé. Les premières collections du Muséum se sont ainsi constituées grâce aux dons et observations rapportées aussi bien par des scientifiques que des amateurs, des passionnés ou de simples curieux. Par la suite, cette activité s’est structurée afin d’obtenir des données scientifiquement exploitables.
Le programme de sciences participatives Vigie-Nature a ainsi été initié en 1989 avec le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC). Aujourd’hui, Vigie-Nature coordonne et anime une vingtaine d’observatoires citoyens s’intéressant à la flore, aux insectes, aux chauves-souris… Les contributeurs sont invités à collecter des informations sur des animaux ou des plantes, strictement dans les mêmes conditions, aux mêmes moments, avec des méthodes et des critères identiques. Cela permet de réaliser des observations sur de larges spectres géographiques et temporels, mais selon des critères standardisés de façon à obtenir des données comparables entre elles.
Quel est l’apport de ces données dans l’étude de la biodiversité ?
Il est énorme ! Car aucun programme de recherche publique ne concerne la biodiversité ordinaire, au contraire par exemple du climat ou d’espèces animales emblématiques telles que les loups ou les ours. Seuls les programmes de sciences participatives ont la puissance nécessaire pour étudier aussi largement cette nature qui nous entoure. Or les insectes, les oiseaux communs, les chauves-souris, les plantes spontanées qui poussent dans les friches, les bois, etc., constituent une biodiversité capitale ! Nous devons nous y intéresser, car elle participe à une quantité de processus essentiels tels que la pollinisation des plantes de consommation, la régulation de l’eau ou du climat.
Cette contribution des citoyens à évaluer la biodiversité et à collecter des données structurées fournit des indications précieuses pour comprendre les mécanismes écologiques. Les quantités et la fiabilité des données recueillies sur des périodes de 10 à 20 ans mettent en évidence le déclin de la biodiversité. Aujourd’hui, il est devenu indispensable et urgent de déterminer l’intensité de ce déclin. Aussi, c’est désormais l’un des moteurs importants du programme, pour les chercheurs comme pour les contributeurs.
Qu’ont révélé ces observations de terrain ?
Elles ont permis d’estimer plus précisément la diminution des populations pressentie par les naturalistes et de mettre en lumière des changements profonds avec des remplacements d’espèces. Certaines espèces déclinent très fortement tandis que d’autres semblent profiter des changements, soit parce qu’elles prennent la place des espèces disparues, soit parce qu’elles sont adaptées au réchauffement climatique, aux pratiques agricoles ou à l’urbanisation. Ces mécanismes s’observent aussi bien chez les oiseaux que chez les insectes ou les plantes.
Les perdantes sont les espèces très spécialisées, c’est-à-dire dépendantes d’habitats et de ressources alimentaires spécifiques pour lesquelles elles sont très performantes mais qui, en contrepartie, ont de faibles capacités d’adaptation. Les gagnantes sont au contraire les généralistes, capables de s’ajuster à différents milieux. Chez les oiseaux par exemple, les alouettes, des oiseaux des champs, déclinent du fait de l’intensification agricole. Les mésanges charbonnières, au contraire, ont tendance à augmenter. Elles vivent aussi bien en milieu boisé, semi-ouvert, en ville, savent trouver des ressources partout, avec en plus des interactions sociales très élevées qui leur permettent, entre autres, de transmettre leurs savoirs à leurs petits.
Mais globalement, le bilan des observations est négatif et même les espèces généralistes commencent à décliner. Les populations d’oiseaux communs ont diminué de 2/3 en moyenne en 15 ans en France. En Allemagne, une étude a mis en évidence une chute de la biomasse d’insectes, c’est-à-dire leur poids total, de 75 % en 27 ans. Les plantes sont également affectées avec des modifications inquiétantes telles que le déclin des plantes pollinisées par les insectes tandis que celles pollinisées par le vent semblent moins souffrir.
Cela témoigne d’un processus général qui se répercute sur l’ensemble de la biodiversité, entraînant un déclin massif : la raréfaction des insectes impacte les oiseaux qui s’en nourrissent, elle prive les plantes d’insectes pollinisateurs indispensables à leur reproduction, puis affecte tous les organismes qui dépendent des plantes, dont certains oiseaux qui mangent leurs graines ou leurs fruits.
Nous ne pouvons pas encore mesurer véritablement l’intensité de ce phénomène d’érosion, mais nous constatons sa brutalité. Et nous en sommes responsables. Il ne fait plus de doute que quasiment 100 % du déclin de la biodiversité est d’origine humaine : nos activités modifient les communautés d’espèces dans une spirale morbide.
Tout savoir sur les insectes
De quelle façon les programmes participatifs confirment-ils l’origine anthropique de ce déclin ?
Ils permettent d’établir des corrélations entre les différents éléments observés. C’est ainsi que l’on constate que le déclin des oiseaux qui nichent au sol en milieu agricole va de pair avec les changements de pratiques agricoles modifiant les paysages et impactant les milieux. L’intensification agricole a conduit à l’extension des champs et l’abattage des haies, créant de vastes étendues ouvertes. Elle s’est accompagnée d’une utilisation croissante de produits phytosanitaires qui, en tuant les insectes, a privé les oiseaux de nourriture et dont certains contaminent en outre les sols ou l’air et se propagent ainsi au-delà des espèces visées. Parfois, des substances chimiques se transmettent aussi via la prédation. Les vautours en Inde ont ainsi perdu 95 % de leurs effectifs en mangeant des charognes de bétail traité avec un anti-inflammatoire1. Par ailleurs, le réchauffement climatique a un impact sur les ressources, les périodes de nidification, les migrations…
- 1Swan GE, Cuthbert R, Quevedo M, Green RE, Pain DJ, Bartels P, Cunningham AA, Duncan N, Meharg AA, Oaks JL, Parry-Jones J, Shultz S, Taggart MA, Verdoorn G, Wolter K. Toxicity of diclofenac to Gyps vultures. Biol Lett. 2006 Jun 22;2(2):279-82. doi: 10.1098/rsbl.2005.0425. PMID: 17148382; PMCID: PMC1618889.
Des solutions se dessinent-elles ?
La bonne nouvelle, c’est que le vivant possède une incroyable capacité à rebondir. Les suivis que met en œuvre la Ligue de protection des oiseaux (LPO) révèlent ainsi que certaines espèces rares et menacées telles que les rapaces ou les Ardéidés (hérons, aigrettes…) reviennent en force depuis 40 ans et deviennent quasiment communes. Cet essor est dû à la mise en place de protections juridiques initiées en 1976. Mais il s’agit en réalité d’un rebond après les massacres de ces espèces aux XIXe et XXe siècles. Aussi, la bonne nouvelle est finalement relative, car nous n’assistons pas à une explosion, mais à une tentative de retour à un état initial qui est loin d’être atteint.
Notre perception est biaisée par ce que l’on nomme la « shifting baseline » (point de référence mouvant) également qualifié en français « d’amnésie écologique ». À chaque génération nous nous habituons à une biodiversité dégradée et oublions ce qui était présent auparavant. En conséquence, nous ne nous rendons pas compte de l’ampleur réelle des nouvelles pertes ou surévaluons l’impact d’un regain éventuel.
Or, nous devons être conscients qu’il existe une dette écologique dont nous ne nous acquitterons pas. Les dégâts infligés aux écosystèmes sont tels que les effets s’en feront sentir durant de nombreuses années. Les pollutions ou le réchauffement climatique notamment agissent avec un effet retard et se ressentent longtemps après que les polluants ont été émis dans les sols ou l’atmosphère. De la même façon, il faudra du temps pour restaurer les milieux dégradés et certaines espèces n’y reviendront jamais.
Alors, oui, la nature occupera les espaces que nous lui rendrons, mais avec des changements profonds. Nous pourrions penser que cela importe peu, puisque la nature s’adaptera. Certes, mais vraisemblablement pas les sociétés humaines telles que nous les connaissons basées sur des modèles de croissance infinie. Nous dépendons de ces ressources que nous surexploitons et modifions largement et à grande vitesse ; nous avons besoin de nous nourrir d’éléments produits par la nature, l’oxygène et même le CO2 nous sont indispensables pour respirer… Et nous sommes nous-mêmes constitués de molécules sensibles aux produits chimiques tels que les néonicotinoïdes.
En Occident, nous pensons que nous trouverons des solutions techniques, mais celles-ci ne sont pas envisageables à grande échelle. Concernant la pollinisation par exemple, si des arboriculteurs peuvent louer des ruches ou polliniser au pinceau dans une serre, cela est impossible sur de larges parcelles
Face à la surpêche, nous développons l’aquaculture, mais il faut 7 kg de poisson sauvage transformés en farine pour produire 1 kg de poisson d’élevage. Nous ne sommes pas capables de suppléer largement à l’absence des services écosystémiques.
Nous pouvons toutefois ralentir, voire inverser la tendance en préservant des espaces naturels et en substituant des activités polluantes à des activités moins polluantes et en pratiquant notamment une agriculture moins intensive.
Il n’est pas question de stigmatiser les agriculteurs, simplement de proposer des alternatives aux pratiques promues par l’industrie agrochimique. La nature peut nous y aider. Une étude américaine d’envergure a ainsi démontré que les chauves-souris contrôlaient les populations de ravageurs des cultures de maïs2.
Certaines espèces mobiles peuvent revenir rapidement dans des milieux restaurés. Par exemple, oiseaux et insectes peuvent recoloniser en quelques semaines les haies nouvellement plantées. Les réserves naturelles ont prouvé leur intérêt pour sauvegarder des populations en raréfaction. Pour préserver les sociétés humaines, il faut désormais composer avec l’ensemble du vivant pour la production de nos ressources. Et donc laisser à la nature une chance de reconquérir de l’espace.
- 2Maine JJ, Boyles JG. Bats initiate vital agroecological interactions in corn. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Oct 6;112(40):12438-43. doi: 10.1073/pnas.1505413112. Epub 2015 Sep 14. PMID: 26371304; PMCID: PMC4603461
Restaurer les haies dans les terres de grandes cultures, une priorité pour la conservation de la biodiversité
Interview réalisée en juin 2024
Entretien avec

Grégoire Loïs
Ornithologue et directeur-adjoint du programme de sciences participatives Vigie-Nature au Muséum national d’Histoire naturelle